La nouvelle du mois : "La Perle de Kyoto"
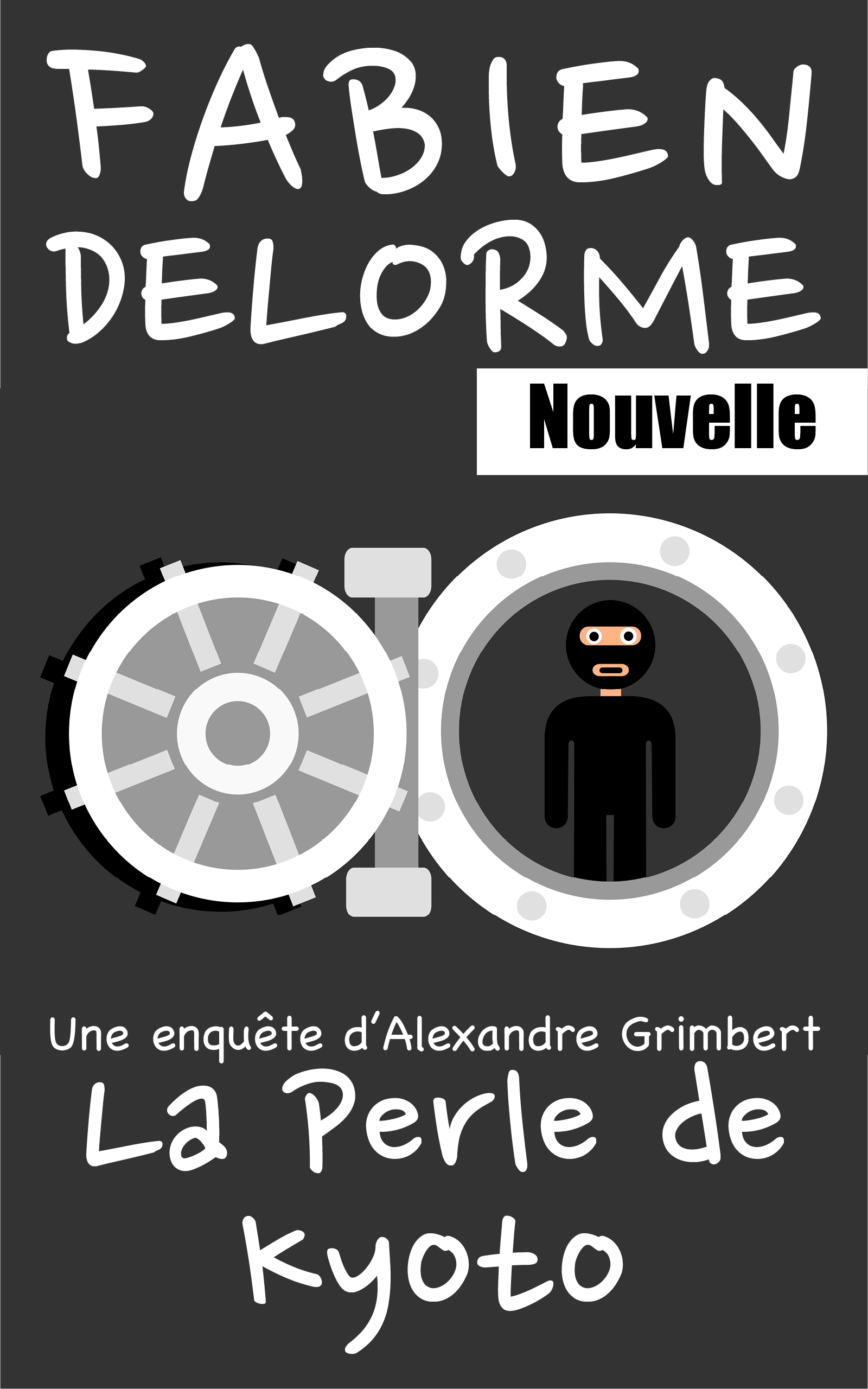
Alors qu'il transporte avec lui une pierre précieuse estimée à plusieurs millions d'euros, Gérard Belon, un commissaire-priseur, reçoit un message. Un cambrioleur lui annonce qu'il volera la pierre dans la nuit.
Afin de protéger la "Perle de Kyoto", Belon se réfugie dans la gendarmerie de Peuffié, où il rencontre Alexandre Grimbert, le détective privé spécialiste des crimes impossibles et des meurtres en chambre close.
Mais, malgré toutes les précautions prises, Alexandre parviendra-t-il à protéger la pierre ?
La Perle de Kyoto raconte l'enquête sans doute la plus déroutante d'Alexandre Grimbert, le spécialiste des mystères inexplicables. Une nouvelle rapide et prenante, pour tous ceux qui aiment se triturer les méninges.
Le premier jour de chaque mois, je vous propose une de mes nouvelles, disponible gratuitement sur ce blog, pendant un mois. “La Perle de Kyoto” est également disponible en version ebook et papier chez la plupart des vendeurs.
Vous avez raté la nouvelle du mois ? Pas d’inquiétude, vous pouvez toujours l’acquérir via l’un des liens ci-dessus, et une autre nouvelle gratuite est disponible quelque part sur le site !